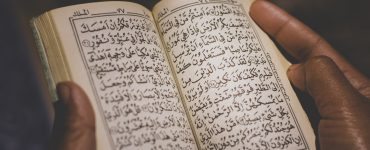Question :
Certaines interdictions dans notre religion ont-elles été instaurées progressivement ?
Réponse :
Le principe de continuité et d’unité entre les législations divines exige une reconsidération de certaines notions et discours liés à l’interprétation du Coran. L’un de ces discours est celui de la gradualité, selon lequel certaines règles auraient été établies en plusieurs étapes avant d’atteindre leur forme définitive.
L’exemple le plus cité à cet égard est l’interdiction des substances enivrantes, notamment l’alcool. Selon cette vision, cette interdiction aurait été instaurée progressivement :
La sourate An-Nahl (16:67) souligne que l’alcool ne constitue pas une bonne subsistance.
La sourate Al-Baqara (2:219) indique que son préjudice est plus grand que son bénéfice.
La sourate An-Nisâ’ (4:43) en interdit la consommation avant la prière.
Enfin, la sourate Al-Mâ’ida (5:90) en décrète l’interdiction formelle.
Un processus similaire aurait eu lieu pour l’interdiction de l’intérêt (ribâ).
Cependant, bien que cette approche puisse sembler rationnelle en tenant compte des réalités sociales et du contexte des révélations, elle entre en contradiction avec le principe de continuité entre les législations divines.
Les prophètes et les Écritures qui leur sont révélées s’inscrivent dans un processus de confirmation (tasdîq). Un prophète qui nierait totalement la législation précédente ne pourrait pas être suivi par les croyants. Ainsi, une personne appliquant la loi d’un prophète précédent ne devrait pas connaître de rupture législative radicale en suivant un nouveau prophète.
Prenons l’exemple d’un adepte des Écritures (Ahl al-Kitâb) qui ne consomme pas d’alcool, ne pratique pas l’usure et ne commet pas l’adultère. Peut-on imaginer que, en embrassant l’Islam sous l’autorité de Muhammad (paix et bénédiction sur lui), cette personne puisse être autorisée à boire de l’alcool, pratiquer l’usure et commettre l’adultère sous prétexte qu’aucune révélation ne les interdit encore explicitement ? Une telle hypothèse reviendrait à admettre qu’un croyant puisse volontairement s’engager dans une période d’incertitude religieuse en attendant des précisions sur des interdits déjà connus auparavant.
Cette idée va à l’encontre de la nature de la foi sincère. Un croyant ne peut abandonner une interdiction simplement parce qu’elle n’a pas encore été confirmée par une nouvelle révélation.
Imaginons que notre propre génération attende un prophète qui viendrait confirmer le Coran. Si ce prophète nous disait :
« Vous ne consommez pas d’alcool ni ne pratiquez l’usure parce que le Coran l’interdit. Mais jusqu’à présent, aucune révélation ne m’a été envoyée sur ce sujet. Je ne peux donc pas vous dire que c’est interdit. »
Serions-nous enclins à suivre un tel prophète ? Abandonnerions-nous nos interdits pour autant ?
Si nous ne pouvons concevoir cette situation pour nous-mêmes, pourquoi l’envisager pour les premiers musulmans ? Cette idée repose sur la perception erronée que tout aurait commencé en l’an 610 de l’ère chrétienne, sans continuité avec les législations antérieures. Or, avant cette date, toute règle en vigueur devait rester applicable jusqu’à nouvel ordre.
Ainsi, les affirmations selon lesquelles certaines interdictions auraient été mises en place progressivement, notamment celles concernant l’alcool et l’usure, doivent être réexaminées. Cette approche compromet le principe fondamental de la confirmation (tasdîq) des révélations antérieures et repose sur une conception erronée d’une rupture entre les législations divines. Cette erreur continue d’influencer certaines approches contemporaines, où l’on tente d’appliquer la gradualité à des questions religieuses actuelles.